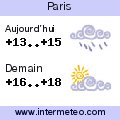Quinze têtes chercheuses
Pôle scientifique majeur, l’Europe produit près d’un tiers des connaissances scientifiques mondiales. Elle est notamment dotée d’une expertise de renom dans la recherche médicale et les sciences de l’environnement. Elle occupe une position avancé dans de nombreux secteurs de la chimie et de la physique. L’aéronautique, l’espace, les télécommunications, les transports, et la pharmacie sont parmi ses principaux points forts en matière de technologie industrielle.
Acquis
Des réalisations comme Airbus et Ariane, ou encore les recherches en physique des hautes énergies développées au CERN, constituent quelques-uns de ses fleurons les plus visibles. Elles montrent que, lorsque les Européens se mettent ensemble, ils peuvent arriver au meilleur niveau. La qualité de ses ressources humaines et de ses systèmes d’éducation et de formation est reconnue. La variété de ses traditions de recherche et sa diversité culturelle lui donnent une précieuse ouverture d’esprit et une créativité particulière dans l’approche des problèmes et des solutions. Son territoire est émaillé d’institutions scientifiques prestigieuses, atteignant un haut niveau d’excellence.
Des signaux d’alarme
Et pourtant... Pourtant, l’Europe « peut mieux faire »... Le dynamisme de sa recherche, selon de nombreux indicateurs, reste inférieur à celui des États-Unis et du Japon. Pourquoi ? En raison, principalement, d’une triple faiblesse : des ressources – matérielles et humaines – insuffisantes, un manque d’innovation, une dispersion des efforts.
L’aura du CERN
Créé en 1954, financé par vingt pays européens, bénéficiant d’une participation américaine et japonaise pour certaines de ses activités, le CERN (Laboratoire européen pour la physique des particules) constitue l’un des plus brillants pôles d’excellence européens. Plus de 7 000 scientifiques du monde entier travaillent dans ses installations de Genève. C’est ici que l’informaticien Tim Berners-Lee, persuadé par la nécessité de coopération entre chercheurs et de la richesse d’exploitation de leurs échanges, inventa le World Wide Web en 1990.
Actuellement, le CERN est aussi un des moteurs du développement du GRID. Ce nouveau réseau est appelé à remplacer Internet en le surpassant pour permettre la gestion partagée des masses énormes de données accumulées par l’informatique scientifique et technologique.
Envols européens
1972. Le premier avion d’Airbus Industrie offrait un confort accru aux passagers, un transport de fret facilité et une rentabilité supérieure. Trente ans plus tard, l’approche novatrice développée par le consortium européen a donné naissance à une large gamme de transporteurs « sur mesure ». Fin 2000, Airbus avait engrangé plus de 4 000 commandes, faisant jeu égal avec Boeing, leader historique. La mise en production de l’A380, le plus gros transporteur civil jamais lancé, confirme les performances de l’aéronautique européenne. À lui seul, cet engin de poids devrait générer quelque 145 000 emplois en Europe.
Ressources financières
Les chiffres sont sévères. À l’échelle de l’Union, les fonds consentis à la recherche stagnent. Ils représentent, en moyenne, 1,8 % du produit intérieur brut (PIB) alors qu’ils sont en nette croissance aux États-Unis (2,7 %) et au Japon (3,1 %). En 1999, alors que le PIB de l’UE et celui des USA étaient comparables, ces derniers ont dépensé 75 milliards d’euros de plus pour la recherche et le développement. Ce fossé s’aggrave depuis 1994. Les États-Unis et le Japon consacrent, en outre, une bien plus grande part des ressources dites de capitalrisque à la création de nouvelles entreprises, en particulier de haute technologie.
Les États-Unis possèdent également une longueur d’avance dans les investissements – au sens large – dans la connaissance (recherche, éducation et formation, développement d’outils logiciels, etc.). Ces efforts leur ont permis, notamment, de réduire le taux de chômage au cours de la dernière décennie.
Ressources humaines
Une même faiblesse se remarque au niveau des ressources humaines. Par rapport à la population active, les chercheurs sont beau-coup moins nombreux en Europe qu’aux États-Unis ou au Japon alors que, paradoxalement, le nombre d’étudiants en sciences y est proportionnellement plus élevé. Compte-tenu de la stagnation des investissements dans la recherche, doit-on s’étonner du manque d’intérêt des jeunes pour les métiers de la recherche et du phénomène – toujours préoccupant – de la fuite des cerveaux ? 83 101 chercheurs et ingénieurs européens travaillaient aux États-Unis en 1997, contre 77 283 en 1993. Et, sur les 8 760 étudiants européens ayant effectué un doctorat aux USA entre 1988 et 1995, la moitié a choisi de poursuivre sa carrière sur place.
Faible concrétisation des performances
Deux indicateurs classiques reflètent le dynamisme en matière de création de connaissances : le nombre de publications de résultats scientifiques et celui des dépôts de brevets au niveau international.
Publications
Si l’Europe se défend plus qu’honorablement dans ce premier domaine, elle fait figure de lanterne rouge dans le second.
Brevets
Dans les secteurs de haute technologie, l’Europe n’assume qu’un peu plus du tiers des brevets déposés sur son territoire (36 %), à égalité avec les ÉtatsUnis (la part du Japon étant de 21 %). En comparaison, elle ne génère respectivement que 9 % et 2 % des brevets déposés aux USA et au Japon.
Ces chiffres, en défaveur du vieux continent, ne s’expliquent pas seulement par un certain manque de culture de l’innovation. Ils sont également dus au coût très élevé et à la complexité du dépôt d’un brevet dans l’ensemble des états membres – ce qui pénalise sensiblement les Européens face à leurs concurrents.
Une dispersion intrinsèque
Les pays européens possèdent des pôles d’excellence spécifiques. Pourtant, même dans les domaines où ils dont individuellement les plus performants, ceux-ci s’affichent rarement au premier rang mondial. Cette absence de leadership, au-delà des indicateurs évoqués ci-dessus, s’explique entre autres par la dispersion européenne.
Puzzle 15 + 1
La fragmentation des compétences à travers quinze états membres – régis par autant de systèmes différents en matière de législations, de réglementations, d’éducation, de financements, de brevets, etc. –, est, à cet égard, un facteur très handicapant.
Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis ou au Japon, la recherche européenne représente un puzzle de quinze politiques scientifiques et technologiques nationales fragmentées. En dehors des quelques accords intergouvernementaux limités à des domaines spécifiques – tels l’espace, l’astronomie ou la physique des particules –, les soutiens limités consentis par l’Union au travers de ses programmes-cadres en faveur de la coopération scientifique et technologique représentent une sorte de « seizième » politique de recherche. Celle-ci s’additionne aux efforts nationaux sans créer une dynamique d’intégration suffisante.
Il est difficile, dans ces conditions, de rassembler la masse critique des moyens humains, technologiques et financiers exigée par les grandes avancées scientifiques contemporaines. Il est malaisé de répondre avec la rapidité et la flexibilité souhaitées aux nouveaux défis engendrés sans cesse par le développement des connaissances.
La structure « 15 + 1 » entraîne le cloisonnement, la dispersion et la duplication des efforts. Les frontières, encore réelles sur bien des points, entravent la mobilité des chercheurs. La difficulté à traduire les progrès scientifiques en produits et procédés largement commercialisables réduit la rentabilité de la recherche et en éloigne donc les capitaux à risques.
Marché commun de la recherche – Le marché européen de l’offre et de la demande des connaissances et des développements technologiques reste encore largement à créer. Son développement et son fonctionnement nécessitent la définition d’une vraie politique de recherche européenne.