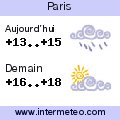Nanotechnologie et agroalimentaire
Les nanotechnologies font recette. Selon certains experts, le marché mondial des nanoproduits pourrait atteindre les 1 000 milliards d’euros dès 2015. « Trois grands domaines sont concernés par cette croissance fulgurante : l’informatique (57 % du total, essentiellement dans l’électronique), les matériaux (32 %) et les sciences du vivant (17 %) », explique Les Echos dans son édition du 24 septembre 2007. Le journaliste précise aussi que « l’an passé, 8,1 Md€ ont été injectés dans la R&D; sur les nanotechnologies ». L’agroalimentaire devrait y trouver sa place. Dans une étude de 2004, le cabinet Helmut Kaiser Consultancy prévoyait une évolution du marché mondial des nanotechnologies pour l’alimentaire de 2,6 Md$ en 2004 à 20,4 Md$ en 2010. Ce même rapport suggérait qu’avec plus de 50 % de la population mondiale, le principal marché des nanotechnologies pour l’alimentaire se trouverait, en 2010, sur le continent asiatique, emmené par la Chine.
Nombreuses applications
Il faut reconnaître que les perspectives d’avenir sont prometteuses. Dans un courrier à l’Efsa (l’Autorité européenne de sécurité des aliments), la Direction « Santé et Protection du consommateur » de la Commission estime que « les applications des nanosciences et des nanotechnologies à la chaîne alimentaire vont du quasi certain (membranes, propriétés antibactériennes, aromatisation, filtration, compléments alimentaires, stabilisants) à l’improbable (fabrication d’une quantité illimitée d’aliments par synthèse au niveau atomique), en passant par le probable (détection de contaminants et de pathogènes, surveillance de l’environnement, dispositif de surveillance et d’alerte) ». De son côté, Alain Mimouni, du CTCPA, indique « qu’on dénombre près de 320 produits utilisant des nanotechnologies sur les marchés américain et asiatique, dont une dizaine de produits alimentaires ».
Entre 0,1 et 100 nm
Les nanotechnologies regroupent en fait l’ensemble des sciences et des techniques visant à comprendre, à produire et à utiliser des objets à l’échelle du nanomètre et plus précisément entre 0,1 et 100 nm, sur au moins une de leurs dimensions. « Il semble qu’il y ait un consensus pour admettre que l’abaissement de la taille des matériaux autour de 100 nm augmente significativement les caractéristiques physiques recherchées telles que la transparence, le changement de couleur, la fluorescence, la conductivité électrique, la perméabilité magnétique, la réactivité de la surface, etc. », explique Alain Mimouni. Il précise aussi : « La taille des nanoparticules n’est pas la seule caractéristique impliquée dans les modifications physicochimiques. En effet, si l’abaissement de la taille favorise la pénétration à travers les fluides biologiques, il semble que cette diminution, ou le rassemblement de molécules, modifient aussi la surface de réactivité qui est alors susceptible d’augmenter les interactions ».
Tout l’enjeu pour les chercheurs est alors de maîtriser puis d’industrialiser la fabrication des nanoobjets afin d’en exploiter les caractéristiques particulières. L’Adria Développement anime ainsi un réseau de partenaires (SMARTech, pour Sensors to Monitor the entire food chain based on Applied and Realistic nanoTechnologies) proposant des applications issues des nanotechnologies. Les pages qui suivent font, quant à elles, le point sur un certain nombre d’applications actuelles ou futures des nanotechnologies en alimentaire, tant dans le domaine de la formulation que de l’emballage ou de l’analyse.
Favoriser la biodisponibilité et l’intensité aromatique
Les nanotechnologies permettent des avancées sur le plan nutritionnel et ouvrent de nouvelles perspectives sur le plan organoleptique.
« L’avantage principal de la nanoencapsulation est de protéger et de vectoriser les molécules d’intérêt nutritionnel », résume Marc Anton, directeur de recherche à l’Inra de Nantes (unité Biopolymères Interactions Assemblages). D’une taille inférieure à 100 nm, les nanocapsules peuvent en effet, si elles sont protégées par une interface adaptée, pénétrer entièrement dans l’organisme... contrairement aux microcapsules qui, elles, doivent se déstructurer dans le tractus intestinal pour libérer leur contenu.
Transfert de la pharmacie et de la cosmétique
La nanoencapsulation est déjà bien connue des industries pharmaceutique et cosmétique. Mais le transfert technologique vers l’alimentaire n’est pas simple. La difficulté réside dans le fait d’incorporer les nanoparticules dans une matrice alimentaire et d’en faire un produit consommable, sachant les contraintes de production que le produit doit subir. « Les travaux ne font que débuter pour connaître la dynamique au cours du temps, la résistance aux traitements. Ce domaine est en ébullition actuellement, tous les grands groupes s’y intéressent », poursuit Marc Anton.
Les nanocapsules sont obtenues par inversion de phase ou par homogénéisation à haute pression. Cette dernière technologie est plutôt utilisée en alimentaire car le matériel requis est déjà bien maîtrisé tandis que la première est plutôt utilisée en pharmacie et en cosmétologie. Enfin, pour résister aux contraintes de la digestion, les nanocapsules doivent être protégées par un film interfacial qui peut être constitué de protéines et de polysaccharides.
Imiter la nature
Mais il existe une autre voie d’obtention de nanocapsules, partant de composés naturels comme les lipoprotéines de jaune d’œuf. Il s’agit d’une gouttelette d’huile, entourée d’un film de protéines et de lécithines.
L’objectif est de partir de cette structure déjà existante et de l’enrichir. Mais cela suppose de rompre la nanocapsule pour pouvoir y introduire la substance et ensuite de reconstruire cette nanocapsule. Une solution naturelle, susceptible de répondre aux inquiétudes engendrées par ces nouvelles technologies. Faisant appel à une autre ressource alimentaire, des chercheurs de Nizo, aux Pays- Bas, ont développé des nanotubes à base d’alpha-lactalbulmine. Sous certaines conditions, l’hydrolyse partielle de l’alpha-lactalbumine, une protéine de lait, par Bacillus licheniformis génère des fragments qui s’assemblent, en présence de calcium pour former des nanotubes de plusieurs micromètres de longueur, avec un diamètre de 20 nm pour une cavité de 8 nm.
Comme l’alpha-lactalbumine est une protéine de lait, il devrait être probablement facile d’utiliser les nanotubes en alimentaire en tant que nouvel ingrédient. Des tests ont montré que les nanotubes d’alphalactalbumine se montrent très stables dans différentes conditions. Ils sont capables de supporter des traitements comme ceux rencontrés dans les procédés industriels, tels que la pasteurisation ou la lyophilisation.
Aromatiser autrement
Sur le plan organoleptique, « les nanoparticules permettent de renforcer l’intensité aromatique ou du moins, pour une même intensité aromatique, de réduire la quantité apportée », explique Vincent Pessey, responsable de missions de la business unit chimie / matériaux, en charge des nanotechnologies depuis six ans, chez Alcimed. En effet, les nanoparticules offrent une plus grande surface d’échange que les particules de taille courante pour une même quantité de matière mise en œuvre. Plus la taille d’une particule diminue, plus les atomes en surface deviennent nombreux par rapport à ceux enfermés à l’intérieur.
Une taille au-dessus
Une fois isolé dans sa capsule, le principe actif doit pouvoir agir le moment voulu. Dans le cas des bactéries probiotiques (bifidobactéries, lactobacilles) microencapsulées, cela permet de les maintenir en vie jusqu’à leur arrivée dans l’intestin où elles seront libérées. La microencapsulation facilite également la mise en œuvre de substances. L’enrobage d’une poudre permet de modifier radicalement ses propriétés d’écoulement et son comportement physique. Par exemple, le sucre brun collant peut être rendu fluide en recouvrant les grains par une fine couche de sucre cristallisé. Enfin, l’encapsulation permet de créer des fonctions nouvelles. L’activité d’un (bio)catalyseur peut, par exemple, être régulée par perméabilisation de la membrane d’encapsulation en fonction du pH.
La production des microparticules est réalisée grâce à un large éventail de technologies et à l’emploi de nombreux composés monomères ou polymères. « Il est impératif de définir correctement l’objectif de l’encapsulation et de connaître les propriétés du matériel à encapsuler pour éviter sa dénaturation ou sa destruction lors du procédé », commente Arnaud Picot, directeur général et cofondateur de Capsulae.
Laboratoires portables pour analyses rapides
Rapidité de réponse, fiabilité et sélectivité des mesures sont les atouts incontestables des nanosystèmes ou microsystèmes d’analyses.
La miniaturisation fera loi dans l’univers de l’analyse biologique. Que ce soit en microbiologie ou en biochimie, les tests de détection, de quantification et d’identification imposent des équipements et des échantillons conséquents.
Récepteurs olfactifs
L’avènement des nanotechnologies pourrait, à terme, changer la donne. Un des outils les plus prometteurs est probablement la réalisation de nanobiosenseurs mettant en œuvre des récepteurs olfactifs. Ils réagissent à d’extrêmement faibles concentrations. Ces structures macromoléculaires disposent d’un haut niveau de spécificité pour les molécules odorantes, permettant la reconnaissance d’une seule molécule ou d’un groupe de molécules. La fixation de la molécule odorante génère un changement de conformation de la structure macromoléculaire qu’il est possible de détecter (génération d’une onde électrique ou autre).
Des dispositifs expérimentaux ont permis de mettre en œuvre ces récepteurs et de détecter des signaux. Ainsi, à terme, la réalisation d’une collection de récepteurs pourrait conduire à l’analyse d’un nombre considérable de molécules. Il faut savoir que les espèces comme le rat ou le chien comptent chacune plus de mille récepteurs différents.
Le champ d’applications en alimentaire est multiple : détection et quantification de molécules, suivi de process (fermentation, apparition de néoformés, contamination liée à l’environnement), contrôle de la qualité de l’eau, présence de germes pathogènes, mesure de flaveurs...
D’autres pistes de recherche exploitant les nanostructures reposent sur des systèmes en usage, depuis plusieurs années, comme les anticorps couplés à des marqueurs fluorescents ou colorés de taille nanométrique.
Billes magnétiques
« Ce principe est particulièrement utilisé en cytométrie de flux pour trier et analyser diverses molécules », explique-t-on chez Mêtis Technologies, fournisseur de ce type de matériels. Les nanoparticules fluorescentes peuvent aussi être appliquées à des fragments d’ADN ou des protéiness (allergènes).
Certains systèmes utilisent des billes magnétiques d’une centaine de nanomètres de diamètre, porteuses d’anticorps.
L’équipe du CEA, de Patrice Caillat, a développé avec ce système un test de détection des antibiotiques dans le lait. Le dispositif met en œuvre un guide d’onde transparent d’une surface de 20 x 75 mm.
Les billes magnétiques porteuses d’anticorps anti-antibiotiques - après introduction dans l’échantillon et lavage - sont acheminées sous la force d’un aimant sur le guide d’onde également porteur d’anti-antibiotiques. Un lecteur de densité optique permet de mesurer la densité des billes et par corrélation la concentration en antibiotiques dans le lait. L’analyse n’excède pas dix minutes. L’équipement dans son ensemble tient dans une boîte à chaussures. D’autres projets utilisant cette puce en silicium et en verre sont prévus pour la recherche de résidus de pesticides, de pathogènes...
Micro-fluidique
Les progrès enregistrés en microfluidique les dimensions des dispositifs utilisés sont de l’ordre du micromètre - offrent aussi, à terme, des perspectives de réactions et d’analyses à l’échelle moléculaire. Les systèmes mettent en œuvre des microcircuits dans des structures de silicium ou à base de silicium dans lesquelles les liquides, quelques picolitres, s’écoulent sans subir de perturbations liées aux parois.
De fait, le diamètre des circuits est suffisamment petit pour que le flux soit laminaire. Il en résulte la possibilité de délimiter des chambres réactionnelles dans lesquelles les interactions moléculaires - de type antigène / anticorps, enzyme / substrat, polysaccharide / protéine - sont facilement détectables à travers des signaux évanescents recueillis, par exemple, par des nanocouches d’or. Ces systèmes qui n’en sont encore qu’au stade de la recherche, exception faite de quelques applications dans l’univers médical. « Ils pourraient à terme permettre le dosage de protéines ou la détection spécifique de germes pathogènes, voire de suivre l’évolution de fermentations. Le gros avantage d’une telle technique est la rapidité des réponses, la faiblesse des tailles d’échantillons et des consommations en réactifs ainsi que le faible encombrement de l’équipement. Le microcirccuit tient dans un dispositif de la taille d’ une pièce d’un euro », explique Bernard Cathala, directeur de recherche à l’Inra de Nantes.
Des emballages intelligents
Propriétés antimicrobiennes, détection de l’altération des aliments ou de stress thermique... autant d’atouts dont les emballages de demain pourraient disposer.
« En matière d’emballage, l’objectif des nanosciences est d’obtenir des morphologies à l’échelle nanométrique possédant des propriétés nouvelles et spécifiques. Ces dernières ne peuvent être atteintes que par l’assemblage maîtrisé de briques élémentaires nanométriques », explique Alain Mimouni, du CTCPA. Par exemple, le Pr. Francesco Ciardelli, de l’Université de Pise, note que « l’ajout de nanosilicates à un polyéthylène basse densité permet d’augmenter ses propriétés barrière et de rigidité ».
Matériaux antimicrobiens
D’ailleurs, selon Dominique Thuault, d’ Adria Développement, « Bayer a développé le Durethan KU2-2601, contenant des nanoparticules de silice, et qui serait à la fois plus léger et plus résistant ». L’américain Nanocor (groupe Amcol International) propose, quant à lui, Imperm, une résine résultant de la dispersion de nanoparticules d’argile dans un nylon MXD6, aux propriétés barrière significativement supérieures au MXD6 seul. Mais, au-delà de ces propriétés bien connues, quelques sociétés s’orientent vers des emballages aux propriétés antimicrobiennes, par adjonction de nanoparticules d’argent à un polymère.
« Il semble que les propriétés bactéricides soient assurées par la lente dissolution des ions argentiques, cytotoxiques pour les bactéries. Si on comprend bien l’efficacité de la grande surface d’argent déployée par des nanoparticules, on comprend moins bien leur efficacité lorsque celles-ci sont enrobées dans une matrice polymère », remarque Alain Mimouni. Il précise également que « Landsdown a récemment développé un matériau en polyuréthane contenant des particules d’argent (100 mg / 100 cm2) libérant 70 ppm d’ions Ag, en associant de la chlorhexidine afin de prévenir la résistance bactérienne ». Plus évolué, Kraft Foods, aidé de chercheurs de l’université américaine de Rutgers, travaillerait actuellement, selon un rapport de Tiju Joseph et Mark Morrison (Institut de nanotechnologie), sur un système de langue électronique intégré à l’emballage.
Détecter le degré d’altération
« Le principe consiste à incorporer à l’emballage une multitude de nanocapteurs extrêmement sensibles aux gaz émis lors de l’altération d’un aliment. Avec pour conséquence une modification de la couleur de ces capteurs et donc de l’emballage, permettant ainsi de visualiser d’un simple coup d’œil si un aliment est toujours bon à consommer ou non ». Dans le même ordre d’idée, Francesco Ciardelli signale que « les recherches actuelles s’orientent vers l’incorporation dans les polymères de nanoparticules dont les caractéristiques électroniques varient en fonction de stimuli extérieurs (température, exposition à la lumière, etc.) ». Des nanocapteurs électroniques, également incorporés au polymère, transmettraient alors l’information à un ordinateur. À noter : des nanoparticules peuvent être incorporées à des matériaux biodégradables pour leur conférer de nouvelles propriétés, notamment barrière, sans qu’ils perdent pour autant leur caractère biodégradable.
Maîtriser les risques
La Commission européenne se mobilise pour mieux comprendre l’influence des nanoparticules sur la santé humaine et l’environnement.
Les propriétés spécifiques des nanoparticules ont amené la Direction générale « Santé et protection des consommateurs » de la Commission européenne (DG Sanco) à se poser la question de leur impact sur la santé humaine et l’environnement. En effet, si selon Lomer et al. (2004), un occidental n’ingèrerait pas moins de 1 012 à 1 014 nano ou microparticules par jour, principalement sous la forme de silicates ou de dioxyde de titane au travers d’aliments et de pâte dentifrice, certains chercheurs s’interrogent sur les effets de ces éléments dans l’organisme.
1012 à 1014 nano ou microparticules par jour
Ainsi, dans son rapport du 22 juin 2007, le Scenihr (Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux) suggère « qu’une attention particulière soit portée sur le fait que le passage de nanoparticules au travers des membranes cellulaires pourrait avoir un effet négatif sur l’organisme, notamment au sein du système cardiovasculaire ou encore par le passage de la barrière entre le sang et le cerveau ».
« Bien qu’aucun risque avéré ne soit identifié, nous avons demandé à l’Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments) de se saisir de la question du risque lié à l’utilisation des nanotechnologies dans l’alimentation, des recherches à mener pour pouvoir y répondre, et ceci en cohérence avec les possibles utilisations des nanotechnologies par les industriels », note Bernardo Delogu, de la DGSanco.
Cette saisie de l’Efsa indique, par exemple, que l’opinion actuelle des experts est que les méthodes toxicologiques et écotoxicologiques en vigueur sur les produits en vrac [dose acceptable en fonction de la masse ingérée] pourraient ne pas être totalement adaptées car ne prendraient, par exemple, pas en compte l’accroissement de la réactivité de surface des nanoparticules, liée à leur faible taille.
Dans son rapport du 22 juin, le Scenihr précisait également que, pour certaines substances, la forme nanométrique n’occasionne pas d’augmentation de la toxicité par rapport à la forme standard et recommande donc une analyse au cas par cas. La question de la possible accumulation des nanoparticules dans le corps humain est également posée. Si beaucoup d’interrogations restent donc à lever, la Commission précise que les produits issus des nanotechnologies dépendent du règlement Novel Food pour les aliments et de la Directive « Food Contact Materials » pour les emballages.