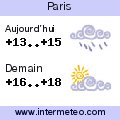Le rôle du rein dans l'équilibre du sodium
Le sel (NaCl) est absorbé, suivant le goût de chacun, à raison de 8 à 15 g/jour. Les 180 litres qui sont filtrés quotidiennement dans les reins contiennent environ 1,5 kg de NaCl (load = charge). Normalement, plus de 99% de cette quantité sont réabsorbés et moins de 1% est excrété. Le rein régule la quantité exacte de Na+ excrétée en fonction de l'absorption de sodium, de telle sorte que la concentration de Na+ et donc le volume extracellulaire restent constants dans l'organisme. Le transport tubulaire du Na+ nécessite une certaine consommation d'énergie tandis que le Cl- est réabsorbé par un transport passif ou un transport actif secondaire. Le NaCl ainsi que l'eau qui le suit passivement sont réabsorbés au niveau du tube contourné proximal sur toute sa longueur. Le liquide réabsorbé, tout comme le liquide restant dans le tubule, est en permanence isotonique au plasma. A l'extrémité du tube proximal, 60 à 70% de la quantité d'eau et de Na+ filtrée sont à nouveau réabsorbés dans le sang. Du fait de la réabsorption simultanée du HCO3-, la réabsorption du Cl- est légèrement postérieure. Les ions H+ sont sécrétés dans la portion initiale du tubule proximal en échange d'ions Na+. Ainsi, les ions HCO3- sont réabsorbés rapidement (environ 85 a 90% sont absorbés pendant le temps de passage du filtrat jusqu'à la fin du tubule proximal). La réabsorption du CI- est plus tardive, mais le gradient électrochimique s'inverse rapidement établissant un passage pour la réabsorption du Cl- (moins de 60 % de la quantité totale filtrée en amont sont réabsorbés dans le tubule contourné proximal).
Mécanisme de la réabsorption « proximale » du Na+
La Na+-K+-ATPase, localisée dans la membrane basolatérale (région basale), constitue le mécanisme de transport actif pour le Na+ qui est pompé de la cellule vers l'interstitium. La concentration cellulaire du Na+ est ainsi maintenue à un niveau bas et de nouveau Na+ peut quitter la lumière tubulaire par un transport passif et parvenir jusque dans la cellule à travers la membrane des cellules à bordure en brosse. Ce flux est maintenu par le gradient électrochimique élevé du Na+ entre la lumière et la cellule; il entraîne le transporteur (« carrier ») à l'aide duquel les ions H+ sont libérés vers la lumière et le glucose, les acides aminés, etc. sont réabsorbés à partir de l'urine primitive. Une fraction importante du Na+ est a priori réabsorbée passivement dans le tube proximal, essentiellement à travers les interstices entre les cellules tubulaires (paracellulaires), contrairement au transport actif. Deux mécanismes sont à l'origine de ce flux transépithélial passif des ions Na+ et Cl- :
- les ions Na+ et Cl- diffusent le long de leur gradient électrochimique de la lumière vers l'interstitium ;
- au transport actif du Na+ et du HCO3- succède un transport paracellulaire de l'eau.
Celle-ci entraîne avec elle les ions Na+ et Cl- (et aussi l'urée) : phénomène dit de «l'entraînement par le solvant » (« solvent drag »).
De plus, 15 à 20% du NaCl filtré sont réabsorbés activement dans le segment large ascendant de l'anse de Henle.
Le transport actif primaire du Na+ est assuré à nouveau par la Na+-K+-ATPase basolatérale, tandis qu'il existe un « carrier » luminal commun au Na+, au K+ et à 2 Cl- (cotransport actif secondaire). Ce transport peut être inhibé par des substances appelées diurétiques comme par exemple le furosémide. Cet épithélium n'est que très peu perméable à l'eau. La perméabilité passive aux ions Na+ et Cl- est également faible, de sorte que ces ions ne peuvent plus rétrodiffuser dans la lumière tubulaire. La pompe à sodium peut donc produire dans la lumière une urine hypotonique et, dans l'interstitium, un milieu hypertonique.
Les 10 à 20% de Na+ restant parviennent jusqu'au tube contourné distal, puis au tube collecteur. Le Na+ (suivi du Cl-) est ensuite réabsorbé activement au niveau de ces deux zones. C'est surtout dans le tube collecteur cortical que la réabsorption du Na+ (par le moyen de canaux Na+ ou de systèmes antiport Na+/H+ dans la membrane luminale) est sous l'influence de l'aldostérone. Cette excrétion varie, suivant l'absorption du sodium et de l'eau, entre 5 % et 0,5 % de la quantité filtrée.
Mais outre l'aldostérone, le TFG, la vasculari-sation médullaire rénale, l'innervation sympathique rénale et les « peptides natriurétiques » auriculaires (PNA) agissent également sur l'excrétion du Na+. La somme de ces effets stimulateurs, mais aussi parfois inhibiteurs (sur des parties du tubule très différentes), détermine en fin de compte l'excrétion des ions Na+ et Cl-.